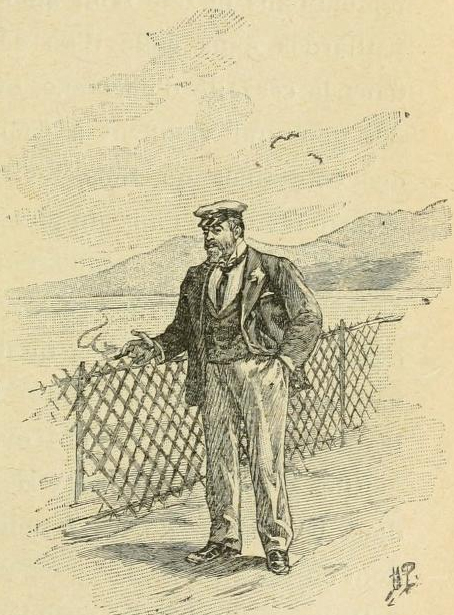| |
Cannes, 7 avril, 9 heures du soir.
Des princes, des princes, partout des princes! Ceux qui aiment les princes sont heureux.
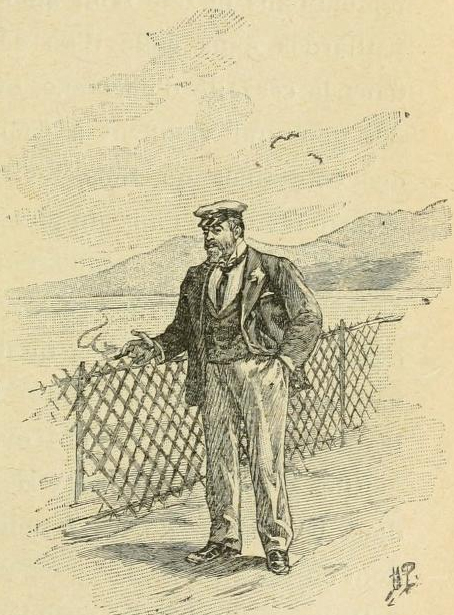
A peine eus-je mis le pied, hier matin, sur la promenade de la Croisette, que j'en rencontrai trois, l'un derrière l'autre. Dans notre pays démocratique, Cannes est devenue la ville des titres.
Si on pouvait ouvrir les esprits comme on lève le couvercle d'une casserole, on trouverait des chiffres dans la tête d'un mathématicien, des silhouettes d'acteurs gesticulant et déclamant dans la tête d'un dramaturge, la figure d'une femme dans la tête d'un amoureux, des images paillardes dans celle d'un débauché, des vers dans la cervelle d'un poète, mais dans le crâne des gens qui viennent à Cannes on trouverait des couronnes de tous les modèles, nageant comme les pâtes dans un potage.
Des hommes se réunissent dans les tripots parce qu'ils aiment les cartes, d'autres dans les champs de courses parce qu'ils aiment les chevaux. On se réunit à Cannes parce qu'on aime les altesses impériales et royales.
Elles y sont chez elles, y règnent paisiblement dans les salons fidèles à défaut des royaumes dont on les a privées.
On en rencontre de grandes et de petites, de pauvres et de riches, de tristes et de gaies, pour tous les goûts. En général, elles sont modestes, cherchent à plaire et apportent dans leurs relations avec les humbles mortels, une délicatesse et une affabilité qu'on ne retrouve presque jamais chez nos députés, ces princes du pot aux votes.
Mais si les princes, les pauvres princes errants, sans budgets ni sujets, qui viennent vivre en bourgeois dans cette ville élégante et fleurie, s'y montrent simples et ne donnent point à rire, même aux irrespectueux, il n'en est pas de même des amateurs d'altesses.
Ceux-là tournent autour de leurs idoles avec un empressement religieux et comique, et, dès qu'ils sont privés d'une, se mettent à la recherche d'une autre, comme si leur bouche ne pouvait s'ouvrir que pour prononcer «Monseigneur« ou «Madame« à la troisième personne.
On ne peut les voir cinq minutes sans qu'ils racontent ce que leur a répondu la princesse, ce que leur a dit le grand-duc, la promenade projetée avec l'un et le mot spirituel de l'autre. On sent, on voit, on devine qu'ils ne fréquentent point d'autre monde que les personnes de sang royal, que s'ils consentent à vous parler, c'est pour vous renseigner exactement sur ce qu'on fait dans ces hauteurs.
Et des luttes acharnées, des luttes où sont employée toutes les ruses imaginables s'engagent pour avoir à sa table, une fois au moins par saison, un prince, un vrai prince, un de ceux qui font prime. Quel respect on inspire quand on est du lawn-tennis d'un grand-duc ou quand on a été seulement présenté à Galles – c'est ainsi que s'expriment les superchics.
Se faire inscrire à la porte de ces «exilés«, comme dit Daudet, de ces culbutés, dirait un autre, constitue une occupation constante, délicate, absorbante, considérable. Le registre est déposé dans le vestibule, entre deux valets dont l'un vous offre une plume. On écrit son nom à la suite de deux mille autres noms de toute farine où les titres foisonnent, où les «de« fourmillent! Puis on s'en va, fier comme si l'on venait d'être anobli, heureux comme si l'on eût accompli un devoir sacré, et on dit avec orgueil, à la première connaissance rencontrée: «Je viens de me faire inscrire chez le grand-duc de Gérolstein.« Puis le soir, au dîner, on raconte avec importance: «J'ai remarqué tantôt, sur la liste du grand-duc de Gérolstein, les noms de X..., Y.... et Z...« Et tout le monde écoute avec intérêt comme s'il s'agissait d'un événement de la dernière importance.
Mais pourquoi rire et s'étonner de l'innocente et douce manie des élégants amateurs de princes quand nous rencontrons à Paris cinquante races différentes d'amateurs de grands hommes, qui ne sont pas moins amusantes.
Pour quiconque tient un salon, il importe de pouvoir montrer des célébrités; et une chasse est organisée afin de les conquérir. Il n'est guère de femme du monde, et du meilleur, qui ne tienne à avoir son artiste, ou ses artistes;. et elle donne des dîners pour eux, afin de faire savoir à la ville et à la province qu'on est intelligent chez elle. Poser pour l'esprit qu'on n'a pas mais qu'on fait venir a grand bruit, ou pour les relations princières... où donc est la différence?
Les plus recherchés parmi les grands hommes, par les femmes jeunes ou vieilles, sont assurément les musiciens. Certaines maisons en possèdent des collections complètes. Ces artistes ont d'ailleurs cet avantage inestimable d'être utiles dans les soirées. Mais les personnes qui tiennent à l'objet tout à fait rare, ne peuvent guère espérer en réunir deux sur le même canapé. Ajoutons qu'il n'est pas de bassesse dont ne soit capable une femme connue, une femme en vue pour orner son salon d'un compositeur illustre. Les petits soins qu'on emploie d'ordinaire pour attacher un peintre ou un simple homme de lettres, deviennent tout à fait insuffisants quand il s'agit d'un marchand de sons. On emploie vis-à-vis de lui des moyens de séduction et des procédés de louange complètement inusités. On lui baise les mains comme à un roi, on s'agenouille devant lui comme devant un dieu, quand il a daigné exécuter lui-même son Regina Coeli. On porte dans une bague un poil de sa barbe; on se fait une médaille, une médaille sacrée gardée entre les seins au bout d'une chaînette d'or, avec un bouton tombé un soir de sa culotte, après un vif mouvement du bras qu'il avait fait en achevant son Doux Repos.
Les peintres sont un peu moins prisés, bien que fort recherchés encore. Ils ont en eux moins de divin et plus de bohème. Leurs allures n'ont pas assez de moelleux et surtout pas assez de sublime. Ils remplacent souvent l'inspiration par la gaudriole et par le coq-à-l'âne. Ils sentent un peu trop l'atelier, enfin, et ceux qui, à force de soins, ont perdu cette odeur-là se mettent à sentir la pose. Et puis ils sont changeants, volages, blagueurs. On n'est jamais sûr de les garder, tandis que le musicien fait son nid dans la famille.
Depuis quelques années, on recherche assez l'homme de lettres. Il a d'ailleurs de grands avantages; il parle, il parle longtemps, il parle beaucoup, il parle pour tout le monde, et comme il fait profession d'intelligence, on peut l'écouter et l'admirer avec confiance.
La femme qui se sent sollicitée par ce goût bizarre d'avoir chez elle un homme de lettres comme on peut avoir un perroquet dont le bavardage attire les concierges voisines, a le choix entre les poètes et les romanciers. Les poètes ont plus d'idéal, et les romanciers plus d'imprévu. Les poètes sont plus sentimentaux, les romanciers plus positifs. Affaire de goût et de tempérament. Le poète a plus de charme intime, le romancier plus d'esprit souvent. Mais le romancier présente des dangers qu'on ne rencontre pas chez le poète, il ronge, pille et exploite tout ce qu'il a sous les yeux. Avec lui on ne peut jamais être tranquille, jamais sûr qu'il ne vous couchera point, un jour, toute nue, entre les pages d'un livre. Son œil est comme une pompe qui absorbe tout, comme la main d'un voleur toujours en travail. Rien ne lui échappe; il cueille et ramasse sans cesse: il cueille les mouvements, les gestes, les intentions, tout ce qui passe et se passe devant lui; il ramasse les moindres paroles, les moindres actes, les moindres choses. Il emmagasine du matin au soir des observations de toute nature dont il fait des histoires à vendre, des histoires qui courent au bout du monde, qui seront lues, discutées, commentées par des milliers et des millions de personnes. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il fera ressemblant, le gredin, malgré lui, inconsciemment, parce qu'il voit juste et qu'il raconte ce qu'il a vu. Malgré ses efforts et ses ruses pour déguiser les personnages, on dira: «Avez-vous reconnu M. X... et Mme Y...? Ils sont frappants.«
Certes, il est aussi dangereux pour les gens du monde de choyer et d'attirer les romanciers, qu'il le serait pour un marchand de farine d'élever des rats dans son magasin.
Et pourtant ils sont en faveur. Donc quand une femme a jeté son dévolu sur l'écrivain qu'elle veut adopter, elle en fait le siège au moyen de compliments, d'attentions et de gâteries. Comme l'eau qui, goutte à goutte, perce le plus dur rocher, la louange tombe, à chaque mot sur le cœur sensible de l'homme de lettres. Alors, dès qu'elle le voit attendri, ému, gagné par cette constante flatterie, elle l'isole, elle coupe, peu à peu les attaches qu'il pouvait avoir ailleurs, et l'habitue insensiblement à venir chez elle, à s'y plaire, à y installer sa pensée. Pour le bien acclimater dans la maison, elle lui ménage et lui prépare des succès, le met en lumière, en vedette, lui témoigne devant tous les anciens habitués du lieu une considération marquée, une admiration sans égale.
Alors, se sentant idole, il reste dans ce temple. Il y trouve d'ailleurs tout avantage, car les autres femmes essaient sur lui leurs plus délicates faveurs pour l'arracher à celle qui l'a conquis. Mais s'il est habile, il ne cédera point aux sollicitations et aux coquetteries dont on l'accable. Et plus il se montrera fidèle, plus il sera poursuivi, prié, aimé. Oh! qu'il prenne garde de se laisser entraîner par toutes ces sirènes de salons, il perdrait aussitôt les trois quarts de sa valeur dans la circulation.
Il forme bientôt un centre littéraire, une église dont il est le Dieu, le seul Dieu; car les véritables religions n'ont jamais plusieurs divinités. On ira dans la maison pour le voir, l'entendre, l'admirer, comme on vient de très loin, en certains sanctuaires. On l'enviera, lui, on l'enviera, elle! Ils parleront des lettres comme les prêtres parlent des dogmes, avec science et gravité; on les écoutera, l'un et l'autre, et on aura, en sortant de ce salon lettré, la sensation de sortir d'une cathédrale. D'autres encore sont recherchés, mais à des degrés inférieurs: ainsi, les généraux, dédaignés du vrai monde où ils sont classés à peine au-dessus des députés, font encore prime dans la petite bourgeoisie. Le député n'est demandé que dans les moments de crise. On le ménage, par un dîner de temps en temps, pendant les accalmies parlementaires. Le savant a ses partisans, car tous les goûts sont dans la nature, et le chef de bureau lui-même est fort prisé par les gens qui habitent au sixième étage. Mais ces gens-là ne viennent pas à Cannes. A peine la bourgeoisie y a-t-elle quelques timides représentants.
C'est seulement avant midi qu'on rencontre sur la Croisette tous les nobles étrangers.
La Croisette est une longue promenade en demi-cercle qui suit la mer depuis la pointe, en face Sainte-Marguerite, jusqu'au port que domine la vieille ville.
Les femmes jeunes et sveltes, – il est de bon goût d'être maigre, – vêtues à l'anglaise, vont d'un pas rapide, escortées par de jeunes hommes alertes en tenue de lawn-tennis. Mais de temps en temps, on rencontre un pauvre être décharné qui se traîne d'un pas accablé, appuyé au bras d'une mère, d'un frère ou d'une sœur. Ils toussent et halètent, ces misérables, enveloppés de châles, malgré la chaleur, et nous regarder passer avec des yeux profonds, désespérés et méchants.
Ils souffrent, ils meurent, car ce pays ravissant et tiède, c'est aussi l'hôpital du monde et le cimetière fleuri de l'Europe aristocrate.
L'affreux mal qui ne pardonne guère et qu'on nomme aujourd'hui la tuberculose, le mal qui ronge, brûle et détruit par milliers les hommes, semble avoir choisi cette côte pour y achever ses victimes.
Comme de tous les coins du monde on doit la maudire cette terre charmante et redoutable, antichambre de la mort, parfumée et douce, où tant de familles humbles et royales, princières et bourgeoises ont laissé quelqu'un, presque toutes un enfant en qui germaient leurs espérances et s'épanouissaient leurs tendresses. Je me rappelle Menton, la plus chaude, la plus saine de ces villes d'hiver. De même que dans les cités guerrières on voit les forteresses debout sur les hauteurs environnantes, ainsi de cette plage d'agonisants on aperçoit le cimetière au sommet d'un monticule.
Quel lieu ce serait pour vivre, ce jardin où dorment les morts! Des roses, des roses, partout des roses. Elles sont sanglantes, ou pâles, ou blanches, ou veinées de filets écarlates. Les tombes, les allées, les places vides encore et remplies demain, tout en est couvert. Leur parfum violent étourdit, fait vaciller les têtes et les jambes.
Et tous ceux qui sont couchés là avaient seize ans, dix-huit ans, vingt ans.
De tombe en tombe, on va, lisant les noms de ces êtres tués si jeunes, par l'inguérissable mal. C'est un cimetière d'enfants, un cimetière pareil à ces bals blancs où ne sont point admis les gens mariés.
De ce cimetière, la vue s'étend à gauche, sur l'Italie, jusqu'à la pointe où Bordighera allonge dans la mer ses maisons blanches; à droite, jusqu'au cap Martin, qui trempe dans l'eau ses flancs feuillus.
Partout, d'ailleurs, le long de cet adorable rivage, nous sommes chez la mort. Mais elle est discrète, voilée, pleine de savoir-vivre et de pudeurs, bien élevée enfin. Jamais on ne la voit face à face, bien qu'elle vous frôle à tout moment.
On dirait même qu'on ne meurt point en ce pays car tout est complice de la fraude où se comptait cette souveraine. Mais comme on la sent, comme on la flaire, comme on entrevoit parfois le bout de sa robe noire! Certes, il faut bien des roses et bien des fleurs de citronniers pour qu'on ne saisisse jamais, dans la brise, l'affreuse odeur qui s'exhale des chambres de trépassés.
Jamais un cercueil dans les rues, jamais une draperie de deuil, jamais un glas funèbre. Le maigre promeneur d'hier ne passe plus sous votre fenêtre et voilà tout. Si vous vous étonnez de ne le plus voir et vous inquiétez de lui, le maître d'hôtel et tous les domestiques vous répondent avec un sourire qu'il allait mieux et que, sur l'avis du docteur, il est parti pour l'Italie. Dans chaque hôtel, en effet, la mort a son escalier secret, ses confidents et ses compères.
Un moraliste d'autrefois aurait dit de bien belles choses sur le contraste et le coudoiement de cette élégance et de cette misère.
Il est midi, la promenade maintenant est déserte et je retourne à bord du Bel-Ami, où m'attend un déjeuner modeste préparé par les mains de Raymond, que je retrouve en tablier blanc et faisant frire des pommes de terre.
Pendant le reste du jour j'ai lu.
Le vent soufflait toujours avec violence et le yacht dansait sur ses ancres, car nous avions dû mouiller aussi celle de tribord. Le mouvement finit par m'engourdir et je sommeillai pendant quelque temps. Quand Bernard entra dans le salon pour allumer des bougies, je vis qu'il était sept heures, et comme la houle, le long du quai, rendait le débarquement difficile, je dînai dans mon bateau.
Puis je montai m'asseoir au grand air. Autour de moi, Cannes étendait ses lumières. Rien de plus joli qu'une ville éclairée, vue de la mer. A gauche, le vieux quartier dont les maisons semblent grimper les unes sur les autres, allait mêler ses feux aux étoiles; à droite, les becs de gaz de la Croisette se déroulaient comme un immense serpent sur deux kilomètres d'étendue.
Et je pensais que dans toutes ces villas, dans tous ces hôtels, des gens, ce soir, se sont réunis, comme ils ont fait hier, comme ils le feront demain et qu'ils causent. Ils causent! de quoi? des princes! du temps!... Et puis?... du temps!... des princes!... et puis?... de rien !
Est-il rien de plus sinistre qu'une conversation de table d'hôte? J'ai vécu dans les hôtels, j'ai subi l'âme humaine qui se montre dans toute sa platitude. Il faut vraiment être bien résolu à la suprême indifférence pour ne pas pleurer de chagrin, de dégoût et de honte quand on entend l'homme parler. L'homme, l'homme ordinaire, riche, connu, estimé, respecté, considéré, content de lui, il ne sait rien, ne comprend rien et parle de l'intelligence avec un orgueil désolant.
Faut-il être aveugle et soûl de fierté stupide pour se croire autre chose qu'une bête à peine supérieure aux autres ! Ecoutez-les, assis autour de la table, ces misérables. Ils causent! Ils causent avec ingénuité, avec confiance, avec douceur, et ils appellent cela échanger des idées. Quelles idées? Ils disent où ils se sont promenés: "la route était bien jolie, mais il faisait un peu froid en revenant" ; "la cuisine n'est pas mauvaise dans l'hôtel, bien que les nourritures de restaurant soient toujours un peu excitantes." Et ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils croient.
Il me semble que je vois en eux l'horreur de leur âme comme on voit un fœtus monstrueux dans l'esprit-de-vin d'un bocal. J'assiste à la lente éclosion des lieux communs qu'ils redisent toujours, je sens les mots tomber de ce grenier à sottises dans leurs bouches d'imbéciles te de leurs bouches dans l'air inerte qui les porte à mes oreilles.
Mais leurs idées, leurs idées les plus hautes, les plus solennelles, les plus respectées, ne sont-elles pas l'irrécusable preuve de l'éternelle, universelle, indestructible et omnipotente bêtise?
Toutes leurs conceptions de Dieu, du dieu maladroit qui rate et recommence les premiers êtres, qui écoute nos confidences et les notes du dieu gendarme, jésuite, avocat, jardinier, en cuirasse, en robe ou en sabots, puis, les négations de Dieu basées sur la logique terrestre, les arguments pour et contre, l'histoire des croyances sacrées, des schismes, des hérésies, des philosophies, les affirmations comme les doutes, toute la puérilité des principes, la violence féroce et sanglante des faiseurs d'hypothèses, le chaos des contestations, tout le misérable effort de ce malheureux être impuissant à concevoir, à deviner, à savoir et si prompt à croire, prouve qu'il a été jeté sur ce monde si petit, uniquement pour boire, manger, faire des enfants et des chansonnettes et s'entre-tuer par passe-temps.
Heureux ceux que satisfait la vie, ceux qui s'amusent, ceux qui sont contents!
Il est des gens qui aiment tout, que tout enchante. Ils aiment le soleil et la pluie, la neige et le brouillard, les fêtes et le calme de leur logis, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils entendent.
Ceux-ci mènent une existence douce, tranquille et satisfaite au milieu de leurs rejetons. Ceux-là ont une existence agitée de plaisirs et de distractions. Ils ne s'ennuient ni les uns, ni les autres.
La vie, pour eux, est une sorte de spectacle amusant dont ils sont eux-mêmes acteurs, une chose bonne et changeante qui, sans trop les étonner, les ravit.
Mais d'autres hommes, parcourant d'un éclair de pensée le cercle étroit des satisfactions possibles, demeurent atterrés devant le néant du bonheur, la monotonie et la pauvreté des joies terrestres.
Dès qu'ils touchent à trente ans, tout est fini pour eux. Qu'attendraient-ils? Rien ne les distrait plus; ils ont fait le tour de nos maigres plaisirs.
Heureux ceux qui ne connaissent pas l'écœurement abominable des mêmes actions toujours répétées; heureux ceux qui ont la force de recommencer chaque jour les mêmes besognes, avec les mêmes gestes, autour des mêmes meubles, devant le même horizon, sous le même ciel, de sortir par les mêmes rues où ils rencontrent les mêmes figures et les mêmes animaux. Heureux ceux qui ne s'aperçoivent pas avec un immense dégoût que rien ne change, que rien ne passe et que tout se lasse.
Faut-il que nous ayons l'esprit lent, fermé et peu exigeant, pour nous contenter de ce qui est. Comment se fait-il que le public du monde n'ait pas encore crié: "Au rideau!", n'ait pas demandé l'acte suivant avec d'autres êtres que l'homme, d'autres formes, d'autres fêtes, d'autres plantes, d'autres astres, d'autres inventions, d'autres aventures?
Vraiment, personne n'a donc encore éprouvé la haine du visage humain toujours pareil, la haine des animaux qui semblent des mécaniques vivantes avec leurs instincts invariables transmis dans leur semence du premier de leur race au dernier, la haine des paysages éternellement semblables, et la haine des plaisirs jamais renouvelés?
Consolez-vous, dit-on, dans l'amour de la science et des arts.
Mais on ne voit donc pas que nous sommes toujours emprisonnés en nous-mêmes, sans parvenir à sortir de nous, condamnés à traîner le boulet de notre rêve sans essor!
Tout le progrès de notre effort cérébral consiste à constater des faits matériels au moyen d'instruments ridiculement imparfaits, qui suppléent cependant un peu à l'incapacité de nos organes. Tous les vingt ans, un pauvre chercheur, qui meurt à la peine, découvre que l'air contient un gaz encore inconnu, qu'on dégage une force impondérable, inexprimable et inqualifiable en frottant de la cire sur du drap, que parmi les innombrables étoiles ignorées, il s'en trouve une qu'on n'avait pas encore signalée dans le voisinage d'une autre, vue et baptisée depuis longtemps. Qu'importe?
Nos maladies viennent des microbes? Fort bien. Mais d'où viennent ces microbes? et les maladies de ces invisibles eux-mêmes? Et les soleils d'où viennent-ils?
Nous ne savons rien, nous ne voyons rien, nous ne pouvons rien, nous ne devinons rien, nous n'imaginons rien, nous sommes enfermés, emprisonnés en nous. Et des gens s'émerveillent du génie humain!
Les arts? La peinture consiste à reproduire avec des couleurs les monotones paysages sans qu'ils ressemblent jamais à la nature, à dessiner les hommes, en s'efforçant sans y jamais parvenir, de leur donner l'aspect des vivants. On s'acharne ainsi, inutilement, pendant des années à imiter ce qui est; et on arrive à peine, par cette copie immobile et muette des actes de la vie, à faire comprendre aux yeux exercés ce qu'on a voulu tenter.
Pourquoi ces efforts? Pourquoi cette imitation vaine? Pourquoi cette reproduction banale de choses si tristes par elles-mêmes? Misère!Les poètes font avec des mots ce que les peintres essaient avec des nuances. Pourquoi encore?Quand on a lu les quatre plus habiles, les quatre plus ingénieux, il est inutile d'en ouvrir un autre. Et on ne sait rien de plus. Ils ne peuvent, eux aussi, ces hommes, qu'imiter l'homme. Ils s'épuisent en un labeur stérile. Car l'homme ne changeant pas, leur art inutile est immuable. Depuis que s'agite notre courte pensée, l'homme est le même; ses sentiments, ses croyances, ses sensations sont les mêmes, il n'a point avancé, il n'a point reculé, il n'a point remué. A quoi me sert d'apprendre ce que je suis, de lire ce que je pense, de me regarder moi-même dans les banales aventures d'un roman?
Ah! si les poètes pouvaient traverser l'espace, explorer les astres, découvrir d'autres univers, d'autres êtres, varier sans cesse pour mon esprit la nature et la forme des choses, me promener sans cesse dans un inconnu changeant et surprenant, ouvrir des portes mystérieuses sur des horizons inattendus et merveilleux, je les lirais jour et nuit. Mais ils ne peuvent, ces impuissants, que changer la place d'un mot, et me montrer mon image, comme les peintres. A quoi bon?
Car la pensée de l'homme est immobile.
Les limites précises, proches, infranchissables, une fois atteintes, elle tourne comme un cheval dans un cirque, comme une mouche dans une bouteille fermée, voletant jusqu'aux parois où elle se heurte toujours.
Et pourtant, à défaut de mieux, il est doux de penser, quand on vit seul.
Sur ce petit bateau que ballotte la mer, qu'une vague peut emplir et retourner, je sais et je sens combien rien n'existe de ce que nous connaissons, car la terre qui flotte dans le vide est encore plus isolée, plus perdue que cette barque sur les flots. Leur importance est la même, leur destinée s'accomplira. Et je me réjouis de comprendre le néant des croyances et la vanité des espérances qu'engendra notre orgueil d'insectes! Je me suis couché, bercé par le tangage, et j'ai dormi d'un profond sommeil comme on dort sur l'eau jusqu'à l'heure où Bernard me réveilla pour me dire:
– Mauvais temps, monsieur, nous ne pouvons pas partir ce matin.
Le vent est tombé, mais la mer, très grosse au large, ne permet pas de faire route vers Saint-Raphaël. Encore un jour à passer à Cannes.
Vers midi, le vent d'ouest se leva de nouveau, moins fort que la veille, et je résolus d'en profiter pour aller visiter l'escadre au golfe Juan.
Le Bel-Ami, en traversant la rade, dansait comme une chèvre et je dus gouverner avec grande attention pour ne pas recevoir à chaque vague qui nous arrivait presque par le travers, des paquets d'eau par la figure. Mais bientôt je gagnai l'abri des îles et je m'engageai dans le passage sous le château fort de Sainte-Marguerite.
Sa muraille droite tombe sous les rocs battus du flot, et son sommet ne dépasse guère la côte peu élevée de l'île. On dirait une tête enfoncée entre deux grosses épaules.
On voit très bien la place où descendit Bazaine. Il n'était pas besoin d'être un gymnaste habile pour se laisser glisser sur ces rochers complaisants.
Cette évasion me fut racontée en grand détail par un homme qui se prétendait et qui pouvait être bien renseigné.
Bazaine vivait assez libre, recevant chaque jour sa femme et ses enfants. Or, Mme Bazaine, nature énergique, déclara à son mari qu'elle s'éloignerait pour toujours avec les enfants s'il ne s'évadait pas, et elle lui exposa son plan. Il hésitait devant les dangers de la fuite et les doutes sur le succès; mais quand il vit sa femme décidée à accomplir sa menace, il consentit.
Alors, chaque jour, on introduisit dans la forteresse des jouets pour les petits, toute une minuscule gymnastique de chambre. C'est avec ces joujoux que fut fabriquée la corde à nœuds qui devait servir au maréchal. Elle fut confectionnée lentement, pour ne pas éveiller de soupçons, puis cachée avec soin dans un coin du préau par une main amie.
La date de l'évasion fut alors fixée. On choisit un dimanche, la surveillance ayant paru moins sévère ce jour-là. Et Mme Bazaine s'absenta pour quelque temps.
Le maréchal se promenait généralement jusqu'à huit heures du soir dans le préau de la prison, en compagnie du directeur, homme aimable dont le commerce lui plaisait. Puis il rentrait en ses appartements, que le geôlier chef verrouillait et cadenassait en présence de son supérieur.
Le soir de la fuite, Bazaine feignit d'être souffrant et voulut rentrer une heure plus tôt. Il pénétra en effet en son logement; mais dès que le directeur se fut éloigné pour chercher son geôlier et le prévenir d'enfermer immédiatement le captif, le maréchal ressortit bien vite et se cacha dans la cour.
On verrouilla la prison vide. Et chacun rentra chez soi.
Vers onze heures, Bazaine sortit de sa cachette muni de l'échelle. Il l'attacha et descendit sur les rochers. Au jour levant un complice détacha la corde et la jeta au pied du mur.
Vers huit heures et demie, le directeur de Sainte-Marguerite s'informa du prisonnier, surpris de ne pas le voir encore, car il sortait tôt chaque matin. Le valet de chambre de Bazaine refusa d'entrer chez son maître.
A neuf heures enfin, le directeur força la porte et trouva la cage abandonnée.
Mme Bazaine de son côté, pour exécuter ses projets, avait été trouver un homme à qui son mari avait rendu jadis un service capital. Elle s'adressait à un cœur reconnaissant, et elle se fit un allié aussi dévoué qu'énergique. Ils réglèrent ensemble tous les détails; puis elle se rendit à Gênes sous un faux nom et loua, sous prétexte d'une excursion à Naples, un petit vapeur italien au prix de mille francs par jour, en stipulant que le voyage durerait au moins une semaine et qu'on pourrait le prolonger d'un temps égal aux mêmes conditions.
Le bâtiment se mit en route; mais à peine eut-il pris la mer que la voyageuse parut changer de résolution, et elle demanda au capitaine s'il lui déplaisait d'aller jusqu'à Cannes chercher sa belle-sœur. Le marin y consentit volontiers et jeta l'ancre, le dimanche soir, au golfe Juan.
Mme Bazaine se fit mettre à terre en recommandant que le canot ne s'éloignât point. Son complice dévoué l'attendait avec une autre barque sur la promenade de la Croisette, et ils traversèrent la passe qui sépare du continent la petite île de Sainte-Marguerite. Son mari était là sur les roches, les vêtements déchirés, le visage meurtri, les mains en sang. La mer étant un peu forte, il fut contraint d'entrer dans l'eau pour gagner la barque, qui se serait brisée contre la côte.
Lorsqu'ils furent revenus à terre, le canot fut abandonné.
Ils regagnèrent alors la première embarcation, puis le bâtiment resté sous vapeur. Mme Bazaine déclara alors au capitaine que sa belle-sœur se trouvait trop souffrante pour venir, et, montrant le maréchal, elle ajouta :
– N'ayant pas de domestique, j'ai pris un valet de chambre. Cet imbécile vient de tomber sur les rochers et de se mettre dans l'état où vous le voyez. Envoyez-le, s'il vous plaît, avec les matelots, et faites-lui donner ce qu'il faut pour se panser et recoudre ses hardes.
Bazaine alla coucher dans l'entrepont.
Or, le lendemain, au point du jour, on avait gagné la haute mer. Mme Bazaine changea encore de projet, et, se disant malade, se fit reconduire à Gênes.
Mais la nouvelle de l'évasion était déjà connue et le populaire, averti, s'ameuta en vociférant sous les fenêtres de l'hôtel. Le tumulte devint bientôt si violent que le propriétaire, épouvanté, fit s'enfuir les voyageurs par une porte cachée.
Je donne ce récit comme il me fut fait, et je n'affirme rien.
Nous approchons de l'escadre, dont les lourds cuirassés, sur une seule ligne, semblent des tours de guerre bâties en pleine mer. Voici le Colbert, la Dévastation, l'Amiral-Duperré, le Courbet, l'Indomptable et le Richelieu, plus deux croiseurs, l'Hirondelle et le Milan, et quatre torpilleurs en train d'évoluer dans le golfe.
Je peux visiter le Courbet, qui passe pour le type le plus parfait de notre marine. Rien ne donne l'idée du labeur humain, du labeur minutieux et formidable de cette petite bête aux mains ingénieuses comme ces énormes citadelles de fer qui flottent et marchent, portent une armée de soldats, un arsenal d'armes monstrueuses, et qui sont faites, ces masses, de petits morceaux ajustés, soudés, forgés, boulonnés, travail de fourmis et de géants, qui montre en même temps tout le génie et toute l'impuissance et toute l'irrémédiable barbarie de cette race si active et si faible qui use ses efforts à créer des engins pour se détruire elle-même.
Ceux d'autrefois, qui construisaient avec des pierres des cathédrales en dentelle, palais féeriques pour abriter des rêves enfantins et pieux, ne valaient-ils pas ceux d'aujourd'hui, lançant sur la mer des maisons d'acier qui sont les temples de la mort?
Au moment où je quitte le navire pour remonter dans ma coquille, j'entends sur le rivage éclater une fusillade. C'est le régiment d'Antibes qui fait l'exercice de tirailleurs dans les sables et dans les sapins. La fumée monte en flocons blancs pareils à des nuées de coton qui s'évaporent, et on voit courir le long de la mer les culottes rouges des soldats.
Alors, les officiers de marine, intéressés soudain, braquent leurs lunettes vers la terre et leur cœur s'anime devant ce simulacre de guerre.
Quand je songe seulement à ce mot, la guerre, il me vient un effarement comme si l'on me parlait de sorcellerie, d'inquisition, d'une chose lointaine, finie, abominable, monstrueuse, contre nature.
Quand on parle d'anthropophages, nous sourions avec orgueil en proclamant notre supériorité sur ces sauvages, les vrais sauvages. Ceux qui se battent pour manger les vaincus ou ceux qui se battent pour tuer, rien que pour tuer?
Les petits lignards qui courent là-bas, sont destinés à la mort comme les troupeaux que pousse un boucher sur les routes. Ils iront tomber dans une plaine, la tête fendue d'un coup de sabre ou la poitrine trouée d'une balle; et ce sont de jeunes gens qui pourraient travailler, produire, être utiles. Leurs pères sont vieux et pauvres; leurs mères qui, pendant vingt ans, les ont aimés, adorés comme adorent les mères, apprendront dans six mois ou un an peut-être que le fils, l'enfant, le grand enfant élevé avec tant de peine, avec tant d'argent, avec tant d'amour, fut jeté dans un trou comme un chien crevé, après avoir été éventré par un boulet et piétiné, écrasé, mis en bouillie par les charges de cavalerie. Pourquoi a-t-on tué son garçon, son beau garçon, son seul espoir, son orgueil, sa vie? Elle ne sait pas. Oui, pourquoi?
La guerre!... se battre!... égorger!... massacrer des hommes!... Et nous avons aujourd'hui, à notre époque, avec notre civilisation, avec l'étendue de science et le degré de philosophie où l'on croit parvenu le génie humain, des écoles où l'on apprend à tuer, à tuer de très loin, avec perfection, beaucoup de monde en même temps, à tuer de pauvres diables d'hommes innocents, chargés de famille et sans casier judiciaire.
Et le plus stupéfiant, c'est que le peuple ne se lève pas contre le gouvernement. Quelle différence y a-t-il donc entre les monarchies et les républiques? Le plus stupéfiant, c'est que la société tout entière ne se révolte pas à ce mot de guerre.
Ah! nous vivrons toujours sous le poids des vieilles et odieuses coutumes, des criminels préjugés, des idées féroces de nos barbares aïeux, car nous sommes des bêtes, nous resterons des bêtes, que l'instinct domine et que rien ne change.
N'aurait-on pas honni tout autre que Victor Hugo qui eut jeté ce grand cri de délivrance et de vérité?
"Aujourd'hui, la force s'appelle la violence et commence à être jugée; la guerre est mise en accusation. La civilisation, sur la plainte du genre humain, instruit le procès et dresse le grand dossier criminel des conquérants et des capitaines. Les peuples en viennent à comprendre que l'agrandissement d'un forfait n'en saurait être la diminution; que si tuer est un crime, tuer beaucoup n'en peut pas être la circonstance atténuante; que si voler est une honte, envahir ne saurait être une gloire.
"Ah! proclamons ces vérités absolues, déshonorons la guerre."
Vaine colère, indignation de poète. La guerre est plus vénérée que jamais.
Un artiste habile en cette partie, un massacreur de génie, M. de Moltke, a répondu un jour aux délégués de la paix, les étranges paroles que voici :
– La guerre est sainte, d'institution divine; c'est une des lois sacrées du monde; elle entretient chez les hommes tous les grands, les nobles sentiments: l'honneur, le désintéressement, la vertu, le courage, et les empêche en un mot de tomber dans le plus hideux matérialisme.
Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre cent mille hommes, marcher jour et nuit sans repos, ne penser à rien ni rien étudier, ni rien apprendre, ne rien lire, n'être utile à personne, pourrir de saleté, coucher dans la fange, vivre comme les brutes dans un hébétement continu, piller les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, puis rencontrer une autre agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang; des plaines de chair pilée mêlée à la terre boueuse et rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes emportés, la cervelle écrabouillée sans profit pour personne, et crever au coin d'un champ, tandis que vos vieux parents, votre femme et vos enfants meurent de faim; voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme !
Les hommes de guerre sont les fléaux du monde. Nous luttons contre la nature, l'ignorance, contre les obstacles de toute sorte, pour rendre moins dure notre misérable vie. Des hommes, des bienfaiteurs, des savants usent leur existence à travailler, à chercher ce qui peut aider, ce qui peut secourir, ce qui peut soulager leurs frères.
Ils vont, acharnés à leur besogne utile, entassant les découvertes, agrandissant l'esprit humain, élargissant la science, donnant chaque jour à l'intelligence une somme de savoir nouveau, donnant chaque jour à leur patrie du bien-être, de l'aisance, de la force.
La guerre arrive. En six mois, les généraux ont détruit vingt ans d'efforts, de patience et de génie.
Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme.
Nous l'avons vue, la guerre. Nous avons vu les hommes redevenus des brutes, affolés, tuer par plaisir, par terreur, par bravade, par ostentation. Alors que le droit n'existe plus, que la loi est morte, que toute notion du juste disparaît, nous avons vu fusiller des innocents trouvés sur une route et devenus suspects parce qu'ils avaient peur. Nous avons vu tuer des chiens enchaînés à la porte de leurs maîtres pour essayer des revolvers neufs, nous avons vu mitrailler par plaisir des vaches couchées dans un champ, sans aucune raison, pour tirer des coups de fusil, histoire de rire.
Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme.
Entrer dans un pays, égorger l'homme qui défend sa maison parce qu'il est vêtu d'une blouse et n'a pas un képi sur la tête, brûler les habitations de misérables qui n'ont plus de pain, casser des meubles, en voler d'autres, boire le vin trouvé dans les caves, violer les femmes trouvées dans les rues, brûler des millions de francs en poudre, et laisser derrière soi la misère et le choléra. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme.
Qu'ont-ils donc fait pour prouver même un peu d'intelligence, les hommes de guerre? Rien. Qu'ont-ils inventé? Des canons et des fusils. Voilà tout.
L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas plus fait pour l'homme, par cette simple et pratique idée d'ajuster une roue à deux bâtons, que l'inventeur des fortifications modernes?
Que nous reste-t-il de la Grèce? Des livres, des marbres. Est-elle grande parce qu'elle a vaincu ou par ce qu'elle a produit?
Est-ce l'invasion des Perses qui l'a empêchée de tomber dans le plus hideux matérialisme?
Sont-ce les invasions des barbares qui ont sauvé Rome et l'ont régénérée?
Est-ce que Napoléon Ier a continué le grand mouvement intellectuel commencé par les philosophes à la fin du dernier siècle?
Eh bien! oui, puisque les gouvernements prennent ainsi le droit de mort sur les peuples, il n'y a rien d'étonnant à ce que les peuples prennent parfois le droit de mort sur les gouvernements.
Ils se défendent, ils ont raison. Personne n'a le droit absolu de gouverner les autres. On ne le peut faire que pour le bien de ceux qu'on dirige. Quiconque gouverne a autant le devoir d'éviter la guerre qu'un capitaine de navire a celui d'éviter le naufrage.
Quand un capitaine a perdu son bâtiment, on le juge et on le condamne, s'il est reconnu coupable de négligence ou même d'incapacité.
Pourquoi ne jugerait-on pas les gouvernements après chaque guerre déclarée? Si les peuples comprenaient cela, s'ils faisaient justice eux-mêmes des pouvoirs meurtriers, s'ils refusaient de se laisser tuer sans raison, s'ils se servaient de leurs armes contre ceux qui les leur ont données pour massacrer, ce jour-là la guerre serait morte... Mais ce jour ne viendra pas.
|